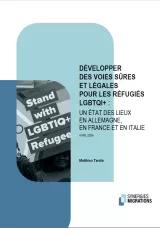En 2015, l’Allemagne a démontré ce qu’il était possible de faire lorsque l’empathie est plus forte que la peur. Dix ans après le fameux « wir schaffen das » [formule prononcée par Angela Merkel pour promouvoir l'accueil des réfugiés « Nous pouvons le faire »], le pays se trouve à un nouveau point de bascule, entre idéal humanitaire et réalité d’une politique migratoire toujours plus restrictive.

1. L’été des migrations et du réveil de l’Europe
L’été 2015 a transformé l’Europe.
Cet été-là, les frontières se sont transformées en files d’attente et les gares en lieux d’espoir. L’élan qui a alors animé la société allemande n’a pas été le fruit du hasard, mais un sursaut moral face au cynisme politique. Des centaines de milliers de personnes ont franchi les frontières, non par choix, mais par nécessité. Elles fuyaient la guerre, la faim, la destruction.
Dans les gares allemandes, des bénévoles les attendaient avec des fleurs et des pancartes « Refugees Welcome ». Ces deux mots sont devenus la devise d’une société qui se surprenait elle-même. L’Allemagne a montré ce qu’un pays peut accomplir lorsque l’empathie l’emporte sur la peur –– mais aussi ce qui survient lorsque les structures politiques échouent.
Car la crise de 2015 n’a pas été provoquée par les flux migratoires, mais par l’inaction politique. Pendant des décennies l’Europe a fermé les yeux alors que les camps de réfugié·e·s débordaient au Liban, en Turquie et en Jordanie, alors que les enfants grandissaient dans des tentes, privés d’école et d’avenir. Lorsque ces enfants, ces femmes et ces hommes se sont mis en route, les gouvernements ont réagi avec surprise, alors qu’ils auraient pu le prévoir.
En décidant d’ouvrir les frontières, Angela Merkel a prononcé une phrase restée dans les mémoires :
« Si nous devons commencer à nous excuser d'avoir montré un visage amical dans une situation d'urgence, alors ce n'est plus mon pays. »
Une décision qui a fait date - et suscité la controverse. Car, là où commence l’humanité, s’arrête souvent le consensus.
2. État d’exception et l’échec des institutions
En 2015, l’Allemagne a fait preuve de compassion – mais pas de préparation. Alors que les citoyen·e·s accueillaient les réfugié·e·s à bras ouverts à Munich, Cologne, Hambourg ou Flensbourg, les administrations cherchaient désespérément des lits, des interprètes et un semblant d’ordre dans le chaos. Les gymnases sont devenus des foyers, les campements des villes, les bureaucraties des obstacles.
Les communes ont été le fer de lance de cette crise. Elles ont organisé, improvisé, et intégré. Et souvent, elles ont dû tout assumer seules.
Nous avons accompli beaucoup dans des conditions extrêmement difficiles. Il est d’autant plus amer de constater, que ces réussites sont aujourd’hui passées sous silence ou minimisées. Une trahison implicite envers tous ceux et toutes celles qui, sur le terrain, ont pris leurs responsabilités.
L’heure de la société civile avait sonné. Les voisin·e·s ouvraient leurs maisons, des initiatives créaient des cafés linguistiques, des associations collectaient des dons. Ces marques spontanées d’humanité n’ont pas été fortuites, mais la preuve que la solidarité peut émerger au cœur même du débordement des institutions. Les années 2015 et 2022 sont un symbole d’humanité et de solidarité. Le meilleur de l’humanité !
Nous avons accompli beaucoup dans des conditions extrêmement difficiles. Il est d’autant plus amer de constater que ces réussites sont aujourd’hui passées sous silence ou minimisées. Une trahison implicite envers tous ceux et toutes celles qui, sur le terrain, ont pris leurs responsabilités.
3. De la volonté au revirement
Alors que l’élan spontané de 2015 prenait forme, un revers se profilait déjà. Ce qui avait débuté comme une promesse humanitaire s’est mué en ferment de discorde politique : débats sur les quotas d’accueil, obligations d’intégration, « culture de référence » ; incendies criminels dans des centres d’hébergement. Un pays tiraillé entre fierté et épuisement, solidarité et cynisme.
La culture d’accueil est devenue un miroir des perceptions. Elle représentait pour certain·e·s le symbole d’une société ouverte, pour d’autres la preuve d’une prétendue perte de contrôle.
Dix ans plus tard, l’Allemagne se trouve à un nouveau tournant. Des fractures apparaissent entre l’exigence d’humanité et les réalités d’une politique migratoire plus restrictive, mais aussi des apprentissages. Les tensions politiques et sociales s’accentuent tandis que l’intégration de nombreux·euses réfugié·e·s sur le marché du travail et dans la société progresse.
Face à l’évolution démographique, la grande question est de savoir si l’Allemagne peut tirer profit des expériences de la décennie passée pour trouver un équilibre durable entre la protection, la participation et la migration de travail contrôlée.
4. 2022, la seconde fracture : l’humanité sélective
En 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine a provoqué une répétition de l’histoire, dans des conditions différentes. Plus de 1,6 million d’Ukrainien·ne·s sont arrivé·e·s en Allemagne. Cette fois, l'État était prêt, les structures opérationnelles, le consensus social large. Tout s’est déroulé comme cela aurait pu se passer en 2015 : hébergement, enregistrement, accès au marché du travail –– plus rapide, plus coordonné et plus pragmatique.
Et pourtant, une question subsistait. Pourquoi, dans ce cas précis, la compassion était-elle si naturelle, alors qu’au même moment des familles syriennes et afghanes étaient refoulées aux frontières extérieures de l’Europe ? L’humanité de l’Europe – sélective et politiquement calculée. Une leçon sur l’empathie et ses limites.
5. Entre espoir et fermeté
Dix ans après, l’heure du bilan est venue. L’Allemagne est plus diversifiée, plus contrastée, plus mûre. Plus de 60 % des réfugié·e·s arrivé·e·s depuis 2015 exercent une activité professionnelle. Beaucoup parlent allemand, ont un travail, une famille, des perspectives et une citoyenneté. L’économie allemande en a profité, discrètement, mais de façon mesurable.
Pourtant, cette réalité est rarement reconnue. Les succès de l’intégration sont occultés, alors que les problèmes sont exagérés. Il semble que la migration ne doive pas « réussir » en Allemagne, sinon, le récit de la surcharge migratoire s’effondrerait.
6. Polarisation et racisme, une menace pour la solidarité
Les dix années écoulées ont montré à quel point la solidarité sociale peut être puissante en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Des citoyen·e·s ont franchi les frontières, soutenu des réfugié·e·s, résisté à la haine. Pourtant, minée par la désinformation, la mobilisation raciste, et les mouvements populistes, cette solidarité subit une pression de plus en plus forte.
Aujourd’hui, les extrémistes de droite occupent plus de 20 % des sièges au Bundestag. Les partis démocratiques adoptent leurs éléments de langage, leur logique, leurs représentations de la peur. Le défi essentiel consiste à défendre la société démocratique multiculturelle et à ancrer durablement la solidarité comme atout politique, social et moral.
7. La question migratoire comme instrument du pouvoir
Le débat politique sur la question migratoire est devenu un débat sur l’âme même de la démocratie.
Cette question dépasse depuis longtemps le cadre des enjeux humanitaires ou de politique du marché du travail. Elle est devenue un instrument de pouvoir politique. Les partis de droite et d’extrême droite l’utilisent pour semer la peur, la haine et la discorde, influencer les élections et déstabiliser les démocraties. La migration est émotionnalisée, déshumanisée, convertie en symbole de la politique identitaire nationale. Cette politique de la peur affecte non seulement les réfugié·e·s, mais aussi des millions d’immigré·e·s pour qui l’Allemagne est depuis longtemps une patrie, des personnes qui se demandent aujourd’hui s’il est souhaitable de rester dans un pays où leur présence est de plus en plus contestée.
Cette tentation du départ ne concerne plus seulement les personnes issues de l’immigration, mais aussi celles qui ne peuvent imaginer vivre dans un pays soumis au fascisme. C’est un signal discret, mais de plus en plus clair : le débat politique sur la question migratoire est devenu un débat sur l’âme même de la démocratie.
8. L’Europe des frontières et des divisions
Alors que l’Allemagne faisait l’apprentissage de l’accueil, l’Europe fermait ses frontières. Dès 2015, l’Union européenne s’est montrée profondément divisée. Certains États membres ont ouvert leurs portes en grand, improvisé des centres d’accueil, mobilisé la société civile et les communes. D’autres ont rejeté toute forme d’accueil, au nom de la souveraineté nationale, transformé la politique migratoire en outil de mobilisation populiste de droite, installé des barbelés, en parlant d’« invasion » et non de protection.
Ce qui se profilait alors est devenu le modèle de la politique migratoire européenne. Tandis que certains pays misaient sur l’humanité, l’UE a opté pour le plus petit dénominateur commun : le repli sur soi. Le nouveau régime d’asile européen commun (RAEC), les accords avec les pays tiers, les refoulements - une politique d’externalisation. Entre 2015 et 2025, plus de 28 000 personnes sont mortes aux frontières extérieures de l’Europe.
La question migratoire est devenue le dilemme moral du continent, l’humanité s’y négocie comme une ressource rare, soumise à condition, stratégique.
9. La migration, un défi pour l’avenir
La migration n’est pas une crise. C’est une constante de l’histoire, elle est synonyme de mouvement, de changement, de renouveau. L’Allemagne a appris que l’humanité et l’ordre ne sont pas incompatibles. Ceux et celles qui arrivent doivent pouvoir s’intégrer avec dignité, chances et perspectives.
Un État moderne doit façonner la migration, et ne pas se contenter de la gérer. Cela implique notamment :
- des compétences fédérales claires pour renforcer les communes;
- des transitions souples entre protection, séjour et travail;
- une répartition européenne des responsabilités plutôt qu’un cloisonnement;
- la participation sociale comme principe fondamental, et non comme preuve d’intégration.
10. La mémoire comme attitude morale, l’avenir comme devoir
Dix ans après « wir schaffen das » ("Nous pouvons le faire" ) – que reste-t-il ? Une phrase, un été, un pays face à ses choix. 2015 a été l’année de l’espoir ; 2016 celle de la fermeté ; 2022 celle de la responsabilité.
Aujourd’hui, nous savons que l’humanité n’est pas un geste politique, mais un choix quotidien. Qui y renonce perd plus que le contrôle ; il se perd lui-même.
La migration n’est pas une exception, mais la norme. Elle nous met à l’épreuve socialement, moralement, politiquement. Mais elle nous offre aussi un horizon.
La migration n’est pas une exception, mais la norme. Elle nous met à l’épreuve socialement, moralement, politiquement. Mais elle nous offre aussi un horizon.
L’humanité n’est pas un luxe, mais la marque de la démocratie. Et l’héritage de cette décennie est clair : c’est en transcendant les frontières que l’on peut façonner la société, et son avenir.
Les opinions et points de vue énoncés dans cet article ne reflètent pas nécessairement ceux de la fondation Heinrich Böll Paris.
Traduction par Pascal Pierron, édition par Céline Michaud | Voxeurop
Cet article est une traduction issue du dossier : heimatkunde.boell.de