« En tout cas, une chose est claire : si je suis un mouton noir - et je ne suis moi-même pas du tout convaincu de l’être -, si donc je le suis, je représente alors une autre sorte qu’oncle Otto. »
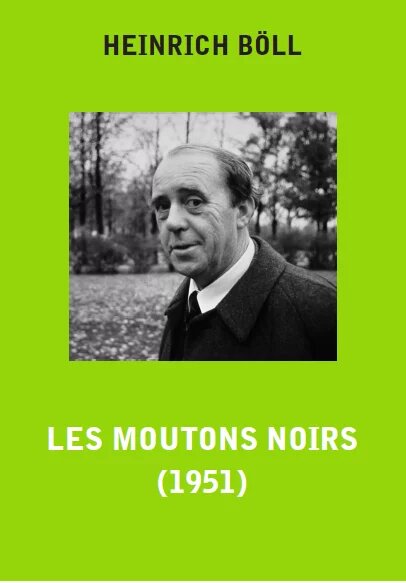
Texte original : Böll, Heinrich: Die schwarzen Schafe (1951)
Apparemment, je suis élu pour veiller à ce que la chaîne des moutons noirs ne soit pas rompue dans ma génération. Il faut que ce soit quelqu’un et c’est moi. Personne ne l’aurait jamais pensé de moi, mais on ne peut rien y changer : c’est moi. De sages personnes de notre famille affirment que l’influence qu’oncle Otto a exercée sur moi n’a pas été bonne. Oncle Otto était le mouton noir de la génération précédente et mon parrain. Il fallait que ce soit quelqu’un et ce fut celui-là. Bien sûr, on l’avait choisi comme parrain avant qu’il se révèle qu’il échouerait ; et moi aussi, on m’a fait être le parrain d’un petit garçon que maintenant, depuis que l’on me tient pour noir, on tient craintivement éloigné de moi. En réalité, on devrait nous être reconnaissant ; car une famille qui n’a pas de mouton noir n’est pas une famille normale.
Mon amitié avec oncle Otto a commencé tôt. Il venait souvent chez nous, apportait plus de bonbons que ce mon père trouvait bon, parlait, parlait et finissait par essayer de pomper de l’argent. Oncle Otto était au courant de tout ; il n’y avait pas un domaine dans lequel il ne s’y connaissait pas : sociologie, littérature, musique, architecture, tout ; et vraiment : il savait quelque chose. Même les experts s’entretenaient volontiers avec lui, le trouvaient stimulant,
intelligent, extraordinairement gentil, jusqu’à ce que le choc de la tentative subséquente de leur pomper de l’argent les dégrise ; car c’était la monstruosité : il ne se déchaînait pas seulement parmi la parenté, mais il posait ses pièges perfides partout où cela lui paraissait en valoir la peine. Tout le monde était d’avis qu’il pourrait « argenter » son savoir, c’est ainsi qu’on nommait cela dans la génération précédente, mais il ne l’argenta pas, il argenta les nerfs de la parenté. Cela reste son mystère de savoir comment il parvenait à donner l’impression qu’il ne le ferait pas ce jour-là. Mais il le faisait. Régulièrement. Impitoyablement. Je crois qu’il ne pouvait pas se résoudre à renoncer à une opportunité. Ses propos étaient si captivants, si emplis de vraie passion, précisément pensés, brillamment drôles, destructeurs pour ses adversaires, édifiants pour ses amis, il pouvait si bien parler de tout que l’on aurait pu croire qu’il…! Mais il le faisait. Il savait comment on s’occupe des nourrissons, bien qu’il n’ait jamais eu d’enfants, il engageait les femmes dans des conversations incroyablement captivantes sur les régimes convenant à certaines maladies, conseillait différents types de poudre, écrivait des recettes de pommades sur des morceaux de papier, réglementait la quantité et la qualité de leurs boissons, oui, il savait comment on les tient : un enfant hurlant qui lui était confié se calmait aussitôt. Quelque chose de magique émanait de lui. Tout aussi bien, il analysait la Neuvième symphonie de Beethoven, rédigeait des documents juridiques, donnait le numéro de la loi dont on parlait, de tête... Mais où qu’ait eu lieu et quelle qu’ait été la conversation, quand la fin approchait, quand le moment de l’adieu impitoyablement venait, généralement dans le couloir, quand la porte était déjà à moitié fermée, il réintroduisait encore une fois sa tête pâle aux yeux noirs et vifs et disait comme si c’était quelque chose de secondaire - dans l’angoisse de la famille qui attendait - au chef de famille : « D’ailleurs, ne peux tu pas me…? »
Les sommes qu’il demandait oscillaient entre un et cinquante marks. Cinquante était le sommet ; au fil des décennies s’était formée la loi non écrite qu’il ne pourrait jamais demander plus. « À court terme ! » ajoutait-il. « À court terme » était son mot préféré. Puis il revenait, posait son chapeau encore une fois sur le porte-manteau, déroulait l’écharpe de son cou et commençait à expliquer pourquoi il avait besoin de cet argent. Il avait toujours des projets, des projets infaillibles. Il n’en avait jamais besoin directement pour lui, mais toujours seulement pour donner enfin à son existence un fondement solide. Ses projets oscillaient entre un stand de limonade, qui lui promettait des revenus réguliers et stables, et la création d’un parti politique qui protégerait l’Europe du naufrage. La phrase « D’ailleurs, ne peux-tu pas me…? » devint un mot de terreur dans notre famille, il y avait des femmes, tantes, grands-tantes, nièces même, qui étaient proches de l’évanouissement quand elles entendaient le mot « à court terme ».
Oncle Otto - je suppose qu’il était parfaitement heureux quand il dévalait les escaliers en partant – allait alors au bistro le plus proche pour réfléchir à ses projets. Il les faisait passer dans son esprit avec un schnaps ou trois bouteilles de vin, selon l’importance de la somme
qu’il avait soutirée. Je ne veux pas cacher plus longtemps qu’il buvait. Il buvait, mais personne ne l’a jamais vu ivre. Par ailleurs, il avait manifestement besoin de boire seul. Lui offrir de l’alcool pour échapper à sa tentative de pomper de l’argent était totalement inutile. Un tonneau de vin entier ne l’aurait pas empêché, lors des adieux, à la toute dernière minute, de remettre sa tête dans la porte et de demander: « D’ailleurs, ne peux-tu pas à court terme...? » Mais j’ai tu jusqu’à présent sa pire qualité : il rendait parfois de l’argent. Parfois, il semblait d’une façon ou d’une autre aussi gagner quelque chose. En tant qu’ancien clerc, il donnait parfois, je crois, des conseils juridiques. Il venait alors, sortait un billet de sa poche, le lissait avec un amour douloureux et disait : « Tu as été si gentil de m’aider, voici le billet de cinq. » Il partait alors très vite et revenait au plus tard après deux jours pour demander une somme légèrement supérieure à celle qui avait été rendue. Cela reste son mystère de savoir comment
il est parvenu à vivre jusqu’à presque soixante ans sans avoir ce que
nous avons l’habitude d’appeler un vrai métier. Et il n’est pas du tout
mort d’une maladie qu’il aurait pu contracter par sa boisson. Il était en
parfaite santé, son coeur fonctionnait fantastiquement et son sommeil
ressemblait à celui d’un nourrisson en bonne santé qui a tété à satiété
et dort avec une conscience parfaite avant le prochain repas. Non, il
est mort très soudainement : un accident a mis fin à sa vie et ce qui se
produisit après sa mort reste la chose la plus mystérieuse à son sujet.
Oncle Otto, comme je l’ai dit, est mort dans un accident. Il a été
renversé par un camion à trois remorques au milieu de l’agitation
de la ville et il a eu la chance qu’un honnête homme le ramasse, le
remette à la police et avertisse la famille. On trouva dans ses poches un
portemonnaie qui contenait une médaille de la mère de Dieu, une carte
de transport avec deux voyages et vingt-quatre mille marks en espèces,
ainsi que le duplicata d’un reçu qu’il avait dû signer au receveur de la
loterie, et il n’a pas pu être plus d’une minute, probablement moins, en
possession de l’argent car le camion le renversa à peine à cinquante
mètres du bureau du receveur de la loterie.
Ce qui suivit avait quelque chose de honteux pour la famille. La
pauvreté régnait dans sa chambre : table, chaise, lit et armoire,
quelques livres et un grand carnet, et dans ce carnet une liste détaillée
de tous ceux qui devaient recevoir de l’argent de sa part, y compris la
mention d’un emprunt du soir précédent qui lui avait apporté quatre
marks. Par ailleurs un testament très court qui me désignait comme
héritier.
Mon père, en tant qu’exécuteur testamentaire, fut chargé de payer les
sommes dues. En fait, les listes de créanciers d’oncle Otto remplissaient
un cahier entier, et la première entrée remontait à ces années où il avait
interrompu son activité de clerc au tribunal et s’était dédié soudain à
d’autres projets dont l’élaboration lui avait coûté tant de temps et tant
d’argent. Ses dettes s’élevaient au total à près de quinze mille marks, le
nombre de ses créanciers à plus de sept cents, en commençant par un
contrôleur de tram qui lui avait avancé trente pfennigs pour un billet
de correspondance, jusqu’à mon père qui avait reçu deux mille marks
au total car c’est à lui qu’oncle Otto avait prêté avec le plus de facilité.
Étrangement, je suis devenu majeur le jour de l’enterrement et j’ai
donc eu le droit de recevoir l’héritage de dix mille marks et j’ai
immédiatement interrompu les études que je venais de commencer pour
me consacrer à d’autres projets. Malgré les larmes de mes parents,
j’ai quitté la maison pour emménager dans la chambre d’oncle Otto,
cela m’attirait tant, et j’y habite encore aujourd’hui bien que mes
cheveux aient commencé depuis longtemps à s’éclaircir. Le mobilier
n’a ni augmenté ni diminué. Je sais aujourd’hui que j’ai mal commencé certaines choses. C’était absurde d’essayer de devenir musicien, de
composer même, je n’ai pas de talent pour cela. Aujourd’hui, je le sais,
mais j’ai payé ce fait avec trois ans d’études vaines et avec la certitude
d’acquérir la réputation de fainéant, par ailleurs, tout l’héritage y est
passé mais c’était il y a longtemps.
Je ne me rappelle plus mes projets successifs, il y en eut trop. Par
ailleurs, les délais qui m’étaient nécessaires pour me rendre compte de
leur absurdité devinrent de plus en plus courts. À la fin, un projet ne
durait plus que trois jours, une durée de vie qui est trop courte même
pour un projet. La durée de vie de mes projets diminua si rapidement
qu’ils n’étaient plus à la fin que des pensées brèves à l’étincelle
passagère que je ne pouvais pas même expliquer à quelqu’un parce
qu’elles n’étaient pas claires pour moi-même. Quand je pense que je me
suis tout de même consacré pendant trois mois à la physiognomonie,
jusqu’à ce que je me décide finalement, en un seul après-midi, à devenir
peintre, jardinier, mécanicien et marin, et m’endorme avec l’idée que
j’étais né pour être enseignant, et me réveille avec la ferme conviction
que la carrière douanière était celle à laquelle j’étais destiné...!
Bref, je n’avais ni l’amabilité d’oncle Otto ni sa relativement grande
persévérance ; par ailleurs je ne suis pas bon causeur, je m’assieds sans
rien dire chez les gens, les ennuie et porte mes tentatives pour leur
arracher de l’argent si abruptement, au milieu d’un silence, qu’elles
sonnent comme du chantage. Ce n’est qu’avec les enfants que je me
débrouille bien, du moins il semble que j’aie hérité de cette qualité
de l’oncle Otto. Les nourrissons se calment dès qu’ils sont dans mes
bras et quand ils me regardent, ils sourient autant qu’ils peuvent
déjà sourire, bien que l’on dise que mon visage effraye les gens. Des
personnes méchantes m’ont conseillé de fonder, en étant son premier
représentant masculin, la branche d’éducateur de maternelle et de
mettre fin à mon interminable politique de projets par la réalisation
de ce projet. Mais je ne le fais pas. Je crois que c’est cela qui nous
rend impossibles : que nous ne pouvons pas argenter nos capacités
réelles ou comme on dit maintenant : les utiliser commercialement.
En tout cas, une chose est claire : si je suis un mouton noir - et je ne
suis moi-même pas du tout convaincu de l’être -, si donc je le suis, je
représente alors une autre sorte qu’oncle Otto : je n’ai pas sa légèreté,
pas son charme et par ailleurs mes dettes m’accablent alors qu’elles
ne lui pesaient apparemment que peu. Et j’ai fait quelque chose
d’horrible : j’ai capitulé ; j’ai demandé un emploi. J’ai adjuré la famille
de m’aider à me loger, de faire jouer leurs relations, afin de m’assurer
une fois, au moins une fois une rétribution fixe pour une certaine
prestation. Et ils y sont parvenus. Après que j’aie cessé les demandes,
formulé les adjurations par écrit et oralement, expressément, suppliant,
je fus horrifié lorsqu’elles furent prises au sérieux et réalisées et j’ai
fait quelque chose qu’aucun mouton noir n’a fait auparavant : je n’ai
pas battu en retraite, je ne me suis pas assis dessus, mais j’ai pris le poste qu’ils avaient trouvé pour moi. J’ai sacrifié quelque chose que
je n’aurais jamais dû sacrifier : ma liberté !
Chaque soir, quand je rentrais fatigué à la maison, je m’irritais de ce
qu’un autre jour de ma vie soit passé, qui ne m’apportait que fatigue,
colère et juste autant d’argent qu’il était nécessaire pour pouvoir
continuer à travailler ; si on peut appeler travail cette occupation :
trier alphabétiquement des factures, les perforer et les mettre dans un
dossier tout neuf où elles endurent patiemment le sort de ne jamais
être payées ; ou écrire des lettres publicitaires qui voyagent sans
succès dans la région et ne sont qu’un fardeau inutile pour le facteur ;
parfois aussi écrire des factures qui furent même à l’occasion payées
en espèces. J’ai dû conduire des négociations avec des représentants
qui s’efforçaient en vain de fourguer à quelqu’un cette camelote que
notre chef fabriquait. Notre chef, ce boeuf agité qui n’a jamais de temps
et ne fait rien, qui perd opiniâtrement en bavardages les précieuses
heures de la journée - existence d’une mortelle absurdité -, qui n’ose
pas s’avouer la hauteur de ses dettes, qui filoute de bluff en bluff, un
acrobate du ballon qui commence à gonfler l’un pendant que l’autre
est sur le point d’éclater : il reste un répugnant chiffon de caoutchouc
qui une seconde auparavant avait encore de l’éclat, de la vie et de
la plénitude.
Notre bureau se trouvait juste à côté de l’usine où une douzaine
d’ouvriers fabriquaient ces meubles que l’on achète pour s’en irriter
toute sa vie si l’on ne se décide pas après trois jours à les briser pour
en faire du bois d’allumage : petites tables basses, tables de couture,
minuscules commodes , petites chaises peintes avec art qui s’effondrent
sous des enfants de trois ans, petits socles pour vases ou pots de fleurs,
bric-à-brac de camelote qui semble devoir sa vie à l’art d’un menuisier
alors qu’en réalité un mauvais peintre en bâtiment leur confère, avec
de la peinture qui est donnée pour du vernis, une beauté factice qui
doit justifier les prix.
J’ai passé ainsi mes jours, l’un après l’autre - il y en eut presque
quatorze - dans le bureau de cette personne inintelligente qui se prenait
elle-même au sérieux et se prenait par ailleurs pour un artiste, car de
temps en temps - cela n’arriva qu’une fois pendant que j’étais là -, on
le voyait devant la planche à dessin, bricolant avec des stylos et du
papier et esquissant quelque objet bancal, une jardinière ou un nouveau
coin-bar, autres sujets d’irritation pour des générations.
La mortelle absurdité de ses appareils ne semblait pas le frapper.
Quand il avait conçu une de ces choses - cela n’arriva, comme je l’ai
dit, qu’une fois pendant que j’étais chez lui -, il partait en trombe avec
sa voiture pour faire une pause créative qui s’étendait sur huit jours
alors qu’il n’avait travaillé que quinze minutes. Le dessin était jeté
au maître artisan qui le posait sur son établi, l’étudiait en fronçant
les sourcils, puis examinait les stocks de bois pour faire démarrer la production. Pendant des jours, j’ai vu alors comment derrière les
vitres poussiéreuses de l’atelier - il l’appelait une usine - les nouvelles
créations s’empilaient : étagères ou petites tables à radio qui valaient
à peine la colle que l’on y gaspillait.
Les seuls objets utiles étaient ceux que les ouvriers fabriquaient à
l’insu du chef, quand son absence était garantie pour quelques jours :
petits repose-pieds ou boîtes à bijoux d’une solidité et d’une simplicité
réjouissantes ; les arrière-petits-enfants continueront à les chevaucher
ou à y garder leurs affaires : étendoir à linge utiles sur lesquels les
chemises de plusieurs générations flotteront encore. Ainsi, tout ce qui
était réconfortant et utile était produit illégalement.
Mais la personnalité vraiment impressionnante que j’ai rencontrée
pendant cet intermezzo d’activité professionnelle, c’était le contrôleur de
tram qui marquait avec son poinçon l’invalidité de ma journée ; il élevait
ce petit bout de papier, ma carte hebdomadaire, le poussait dans la
gueule ouverte de sa pince, et une encre au flux invisible en rendait deux
centimètres - un jour de ma vie - caducs, un jour précieux, qui ne m’avait
apporté que fatigue, colère et autant d’argent qu’il était nécessaire pour
poursuivre encore cette occupation absurde. Une grandeur fatidique
résidait dans cet homme au simple uniforme des transports urbains
qui chaque soir pouvait déclarer nuls des milliers de jours humains.
Aujourd’hui encore, je m’irrite de ne pas avoir quitté mon chef avant
d’avoir été presque obligé de le quitter ; de ne pas avoir envoyé
promener sa camelote avant d’avoir été presque obligé de l’envoyer
promener : car un jour, ma propriétaire introduisit au bureau une
personne au regard sombre, qui se présenta comme receveur de la
loterie et m’expliqua que je possédais une fortune de 50 000 marks,
si j’étais bien tel et tel et si un certain ticket se trouvait entre mes
mains. Eh bien, j’étais tel et tel, et le ticket se trouvait entre mes
mains. Je quittai mon poste immédiatement sans préavis, je pris sur
moi de laisser les factures non perforées, non triées, et il ne me restait
rien d’autre à faire que de rentrer chez moi, d’encaisser l’argent et
d’informer la parenté du nouvel état des choses par l’intermédiaire
du facteur de mandats postaux.
Apparemment, on s’attendait à ce que je meure bientôt ou que je sois
victime d’un accident. Mais pour le moment, aucune voiture ne semble
avoir été élue pour me priver de la vie et mon coeur est en parfaite
santé, bien que moi non plus je ne dédaigne pas la bouteille. Je suis
donc, après payement de mes dettes, le propriétaire d’une fortune de
près de 30 000 marks, libre d’impôt, suis un oncle recherché qui a
soudainement de nouveau accès à son filleul. En général, les enfants
m’aiment et j’ai maintenant le droit de jouer avec eux, de leur acheter
des balles, de les inviter à manger de la glace, de la glace avec de la
crème, j’ai le droit d’acheter d’énormes bouquets de ballons, de peupler
les balançoires et les carrousels avec une joyeuse bande.
Alors que ma soeur a tout de suite acheté un ticket pour son fils, mon
filleul, je m’occupe maintenant à réfléchir, ruminer pendant des heures,
à qui me suivra dans cette génération qui grandit là-bas ; qui parmi
ces enfants épanouis, joueurs, beaux, que mes frères et soeurs ont
mis au monde sera le mouton noir de la prochaine génération? Car
nous sommes et resterons une famille caractéristique. Qui sera sage
jusqu’au point où il cessera d’être sage ? Qui voudra soudainement
se consacrer à d’autres projets, infaillibles, meilleurs ? Je voudrais le
savoir, je voudrais l’avertir, car nous aussi nous avons nos expériences,
notre métier aussi a ses règles du jeu que je pourrais lui communiquer,
à lui le successeur, qui est provisoirement encore inconnu et qui joue
dans la horde des autres comme le loup en peau de mouton...
Mais j’ai le sombre pressentiment que je ne vivrai pas assez longtemps
pour le reconnaître et l’introduire aux mystères ; il paraîtra, il se
révélera quand je mourrai et que la relève sera nécessaire, il ira vers
ses parents avec un visage brulant et dira qu’il en a assez, et j’espère
secrètement qu’il restera encore un peu de mon argent car j’ai changé
mon testament et j’ai légué le reste de ma fortune à celui qui le premier
montre les signes indéniables qu’il est destiné à me suivre...
L’ essentiel est qu’il ne leur reste redevable de rien.
Texte original : Böll, Heinrich: Die schwarzen Schafe (1951),
in: Böll, Heinrich: Werke. Kölner Ausgabe. Band 5. 1951 ;
Herausgegeben von Robert C. Conrad, © 2004, Verlag
Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln.
Traduction : Bertrand Brouder (2020)
Tous droits réservés.
Avec l’aimable autorisation de Kiepeneheuer & Witsch.