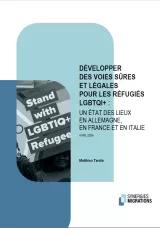Il y a trente ans, le terme d’« Europe forteresse » n'était encore qu'une image. Personne n’envisageait qu’elle se traduirait un jour par plus de 2 000 kilomètres de frontières extérieures « protégées » par des murs, des clôtures et des fossés bien réels. Mais chaque forteresse est dotée de passerelles qui permettent d’y accéder. Pourquoi certaines personnes sont exemptées de visa, tandis que d'autres n'ont pour unique choix que de s'élancer sur une route migratoire dangereuse et incertaine ? Le système des "passerelles", ou voies légales, permettant d'accéder à l'UE devrait être mieux identifié et encadré par la politique migratoire des Etats membres de l'UE.

-
Frontières fermées, passerelles ouvertes
Au début des années 90, le terme d’« Europe forteresse » a fait son apparition pour désigner la politique restrictive des États membres de l’UE en matière d’asile et d’immigration. Au sens strict, l’image de la forteresse devait refléter le lien entre la politique restrictive commune de l’UE en matière de visas, le renforcement des contrôles aux frontières et les sanctions contre les transporteurs qui ne contrôlent pas suffisamment les documents d’entrée. Actuellement, les ressortissant·es de 102 pays doivent disposer d’un visa pour se rendre dans l’UE. Ceci concerne tous les pays d’Afrique, les pays du Moyen-Orient sauf Israël, l’Asie centrale et de nombreux pays d’Asie orientale et d’Amérique latine. La liste des différents motifs justifiant la délivrance d’un visa ne comprend pas « l’asile » ou la « protection juridique internationale ». Bien au contraire, les consulats des États membres de l’UE doivent examiner chaque demande de visa pour déterminer le « risque » que la personne demande l’asile à la frontière ou après son entrée sur le territoire, et si le motif de « visite familiale » ne constitue pas un prétexte pour travailler dans un pays de l’UE.
Il y a 30 ans, le terme d’« Europe forteresse » était encore une image et personne n’envisageait qu’il se traduirait un jour par des murs, des clôtures et des fossés réels. Aujourd’hui, plus de 2 000 kilomètres de frontières extérieures sont « protégés » par de telles infrastructures, soit environ 15 % de la longueur totale des frontières terrestres. En 2014, ce chiffre ne s’élevait qu’à 315 kilomètres[1].
À présent, l’UE et certains États membres ont passé des accords avec presque tous les pays riverains de la Méditerranée, en Afrique du Nord et au Proche-Orient et ont investi des milliards d’euros dans la lutte contre les départs irréguliers depuis ces pays[2].
La forteresse est érigée et se renforcera encore. Revenir en arrière ou contenir cette évolution parait irréaliste. Mais chaque forteresse est dotée de passerelles qui permettent d’y accéder. La question qui se pose, sans doute l’une des plus pressantes de la politique migratoire de l’UE, est d’identifier ces passerelles, leur fonctionnement, et qui a le droit de les emprunter pour entrer légalement et en toute sécurité dans les pays européens.
-
Exemption de visa pour entrer dans l’UE : les modèles ukrainiens et vénézuéliens
Les États sont confrontés à un dilemme : d’une part, ils souhaitent faciliter l’entrée sur leur territoire pour des raisons économiques et politiques, d’autre part, ils souhaitent limiter la mobilité pour des raisons de sécurité, de politique démographique et renforcer les contrôles. De ce fait, les ressortissant·es de certains pays sont privilégié·es et leur entrée sur le territoire pour travailler est même activement encouragée, comme dans le cadre de la politique des « travailleur·euses immigré·es » des années 50 et 60, ou à l’heure actuelle concernant les personnes hautement qualifiées. En parallèle, l’entrée sur le territoire de migrant·es en provenance d’autres pays, notamment des plus pauvres, ou de groupes de migrant·es et de réfugié·es « indésirables » est interdite ou compliquée. Dans une étude qui ne se limite pas à l’UE, Eric Neumayer a démontré que les réglementations restrictives en matière de visas affectent principalement les pays les plus pauvres, non démocratiques et exposés à des conflits militaires en cours ou potentiels. À l’inverse, des relations commerciales et financières fortes avec un pays, des affinités culturelles substantielles ou des flux touristiques importants représentent des atouts en matière de politique d’entrée sur le territoire[3].
Des exceptions à cette règle existent toutefois, comme le Venezuela, exempté de l’obligation de visa depuis 2016, ou l’Ukraine, depuis 2017, tous deux devenus ces dernières années les principaux pays d’origine des réfugié·es dans l’UE.
Les réfugié·es de ces pays dispensé·es de l’obligation de visa peuvent choisir, dans les 90 jours suivant leur entrée dans l’espace Schengen, le pays dans lequel ils/elles souhaitent déposer une demande de protection juridique. Comme ils/elles sont entré·es légalement, les règles de Dublin relatives à la responsabilité du pays de première entrée ne s’appliquent pas. Daniel Thym parle de la réintroduction surprenante, de facto, du « modèle du libre choix » pour les demandeur·euses d’asile[4]. Bien que le nombre de réfugié·es ukrainien·nes dans les pays de l’UE, à savoir 4,4 millions, s’avère bien supérieur à celui enregistré lors de la « crise migratoire » de 2015, au cours de laquelle 1,3 million de demandes d’asile au total furent déposées dans l’UE, l’opinion publique et politique ne s’est pas émue de la même façon.
Une extension du nombre de pays dont les ressortissant·es pourraient entrer dans l’UE sans visa contribuerait de manière significative à apaiser la situation actuelle en matière d’asile et de migration. Une telle mesure permettrait
- de réduire le nombre de victimes en Méditerranée et, sur d’autres routes migratoires,
- de rendre le système de Dublin largement superflu,
- de priver les passeur·euses d’au moins une partie de leur « marché »
- d’apaiser le débat sur les entrées irrégulières,
- de donner une nouvelle importance au principe de légalité dans la politique migratoire.
Il convient, à la lumière de données factuelles, de relativiser les craintes relatives à un « afflux massif » de demandeur·euses d’asile et de migrant·es après la suppression des visas. La majorité des réfugié·es dans le monde, soit 67 % selon le HCR[5], restent dans une région proche de leur pays d’origine et n’envisagent pas ou ne peuvent pas poursuivre leur migration. Le cas des Vénézuélien·nes est révélateur : 6 millions d’entre eux/elles ont fui ces dernières années vers les pays voisins tels que la Colombie, le Pérou, le Brésil et l’Équateur. Malgré la dispense de visa, le nombre de demandeur·euses d’asile vénézuélien·nes qui se tournent vers l’UE s’avère relativement faible : 73 000, soit 8 % de l’ensemble des demandeur·euses d’asile en 2024, malgré une augmentation relative au cours des premiers mois de 2025[6]. Par ailleurs, la plupart d’entre eux/elles sont resté·es en Espagne, le pays européen avec lequel ils/elles ont la plus grande affinité culturelle et linguistique, et donc sans recourir à la possibilité de se rendre légalement dans d’autres pays de l’UE. Il convient aussi de rappeler qu’après le début de la guerre civile de 2011, les réfugié·es syrien·nes sont resté·es de nombreuses années essentiellement dans les pays limitrophes, la Turquie, le Liban et la Jordanie, et qu’ils/elles ne sont arrivé·es en nombre en Europe occidentale qu’après la forte réduction de l’aide humanitaire internationale dans ces pays. Le moment est venu pour l’UE de procéder à une évaluation approfondie de la suppression progressive de l’obligation de visa.
-
La réinstallation consiste-t-elle simplement à faire du neuf avec du vieux ?
Selon la définition du HCR, la réinstallation consiste dans le transfert volontaire, sûr et réglementé de réfugiés en situation de vulnérabilité depuis leur pays de premier accueil vers un pays tiers qui les accueille, en tant que réfugiés, et leur accorde un statut de résident·e permanent·e. La réinstallation représente une solution à long terme qui concerne principalement les réfugié·es les plus fragiles, dont la vie, la liberté, la sécurité ou les droits fondamentaux sont compromis dans le pays d’accueil. La réinstallation figure déjà dans les statuts du HCR de 1950 comme troisième option pour résoudre durablement le problème des réfugié·es lorsque les deux autres options, le retour volontaire dans le pays d’origine et l’intégration dans le pays d’accueil s’avèrent inapplicables. Traditionnellement, les États-Unis, le Canada et l’Australie constituaient les principaux pays d’accueil tandis qu’en Europe, seuls les pays scandinaves accueillaient un nombre nettement moins important de réfugié·es. Dans l’UE, le nombre de places de réinstallation a oscillé jusqu’en 2015 à un niveau inférieur à 5 000 par an. Ensuite, du fait de la « crise migratoire » et de l’accord conclu entre l’UE et la Turquie en 2016, ce nombre a progressé régulièrement pour atteindre 27 000 en 2019, avant de diminuer à environ 14 000 par an en 2023 et 2025 ; deux pays, l’Allemagne et la France, en ont accueilli 60 %. L’une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement américain a consisté à réduire drastiquement le programme américain de réinstallation, largement renforcé sous l’administration Biden. Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, craint que les places de réinstallation dans le monde, qui culminaient à environ 190 000 en 2024, n’enregistrent en 2025 la plus forte baisse des 20 dernières années, alors que les besoins totaux sont estimés à 2,5 millions.
En mai 2024, dans le cadre du dispositif législatif du « nouveau pacte » sur la politique d’asile et de migration, l’UE a adopté une directive-cadre relative à la réinstallation et à l’accueil humanitaire des réfugié·es[7]. Au cours du débat sur le nouveau pacte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné à maintes reprises l’importance des « voies d’accès complémentaires » pour les réfugié·es et les migrant·es dans l’UE. Pour l’UE, la réinstallation et l’accueil humanitaire doivent avant tout servir à créer des possibilités d’entrée légale.
Selon la directive-cadre, la réinstallation constitue une mesure librement consentie par les États membres. Bien qu’un programme de deux ans prévoie la fixation d’objectifs quantitatifs, aucun État n’a aucune obligation légale de participer à ce programme. L’UE garantit toutefois des incitations financières : pour chaque réfugié·e accueilli·e volontairement, les États reçoivent une contribution de 10 000 euros par personne. Les réfugié·es retenu·es pour le programme, en principe par le HCR ou en collaboration avec celui-ci, entrent légalement dans le pays de l’UE qui a ouvert des places et obtiennent « automatiquement » un titre de séjour permanent sans devoir suivre une nouvelle procédure d’asile. Ils/elles bénéficient aussi du regroupement familial. Dans le cadre de la sélection effectuée dans les pays de premier accueil, les personnes particulièrement vulnérables sont prioritaires, sans tenir compte du critère des chances d’intégration future.
La réinstallation représente sans conteste un mécanisme essentiel pour l’entrée et l’accueil sécurisé des réfugié·es. Au cours des dix dernières années, ce mécanisme a connu un essor formidable dans l’UE et dispose désormais d’un cadre juridique. Toutefois, dans la mesure où son niveau se situe entre 2 et 3 % environ de l’ensemble des demandeur·euses d’asile qui entrent spontanément sur le territoire, cette « passerelle » est trop étroite pour constituer une véritable alternative à la migration clandestine.
Accueil humanitaire, la société civile comme modèle
En 2016, des organisations non gouvernementales, majoritairement affiliées aux Églises catholiques et protestantes, ont élaboré en Italie un « corridor humanitaire » pour permettre à certains contingents de réfugié·es d’entrer légalement depuis les pays de premier accueil au Proche-Orient et en Afrique. Sous réserve de financement intégral des frais de voyage, d’accueil et d’intégration par des fonds privés, les ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur ont conclu des accords de contrôle de sécurité et de délivrance de visas par les consulats italiens concernés. Le règlement de Schengen sur les visas autorise, « à titre exceptionnel », la délivrance de visas humanitaires valides uniquement pour le pays qui les délivre, c’est-à-dire contrairement aux visas Schengen ordinaires, qui ne permettent pas de se rendre dans d’autres pays de l’UE.
Ce modèle, accueilli favorablement dans les médias et l’opinion publique, a aussi fait l’objet d’une expérimentation en France et en Belgique. Au total, l’accueil a concerné 8 400 réfugié·es, la plupart en Italie. En 2025, l’Italie encore a ouvert ses portes à des réfugié·es afghan·nes et à des Palestinien·nes de Gaza. Les « couloirs humanitaires » constituent un exemple de coopération entre les institutions publiques et privées dans l’accueil des réfugié·es, qui mériterait d’être grandement élargi, à la fois en ce qui concerne nombre de pays participants de l’UE et le nombre de places disponibles.
-
Le parrainage communautaire, une solution importée du Canada
L’idée est simple : l’État fixe certains quotas pour la réinstallation ou l’accueil humanitaire, et autorise l’entrée des réfugié·es parrainé·es par la société civile. Dans ce cas, des communautés au sens large, des collectifs de quartier, religieuses et, dans certains cas, des membres de la famille qui résident dans le pays, par solidarité et pour des raisons humanitaires, prennent en charge les frais d’accueil pendant une période déterminée, accompagnent et soutiennent l’intégration des réfugié·es. Les couloirs humanitaires constituent une forme de parrainage communautaire. Non seulement au Canada, où le modèle a vu le jour et est à l’épreuve depuis de nombreuses années, qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays d’Amérique du Sud par la suite, où différentes formes de parrainage communautaire furent développées au cours des dernières années[8]. L’objectif consiste non seulement à permettre à un certain nombre de réfugié·es d’entrer légalement dans le pays, mais aussi, sur le plan stratégique, à inciter les États à œuvrer davantage pour les voies d’entrée légales.
-
Demandes d’asile auprès des ambassades
Il y a 20 ans déjà, la Commission européenne a lancé une étude approfondie sur la faisabilité des procédures d’entrée protégée (Protected Entry Procedures, PEP). Bien que le texte présenté par Gregor Noll[9] se soit invité dans le débat politique, notamment au Parlement européen, il n’a pour autant jamais fait l’objet de publication ultérieure, pas même dans les programmes quinquennaux de la Commission européenne. Les PEP visent à permettre aux réfugié·es de déposer une demande d’asile auprès d’une représentation diplomatique du pays d’accueil souhaité. Après audition de la personne concernée, réalisable aujourd’hui en ligne par l’autorité nationale compétente en matière d’asile, et un examen sommaire de la demande, si le résultat est positif, un visa d’entrée doit être délivré, afin d’effectuer cette procédure d’asile dans le pays désigné par le/la demandeur·euse.En cas de refus, un recours devant le tribunal compétent devrait être prévu. Certains pays comme la Suisse et l’Espagne ont testé la procédure d’ambassade avant de l’abandonner, au motif principal qu’un tel modèle devait être promu à l’échelle européenne et non seulement par certains États. Néanmoins, en août 2025, un tribunal de Rome a ordonné à l’ambassade italienne à Tel-Aviv de délivrer un visa humanitaire à une famille gazaouie[10]. Le débat sur la procédure d’ambassade, qui, contrairement à la réinstallation et à l’accueil humanitaire, ne prévoit pas de quotas fixes, devrait être relancé et intégré dans la stratégie de l’UE.
-
Regroupement familial élargi
Plusieurs études ont montré que de nombreux réfugié·es et migrant·es entrent illégalement dans l’UE afin de rejoindre des proches qui y résident, et non pas d’abord pour des raisons de protection ou d’emploi. La directive européenne sur le regroupement familial repose sur une conception étroite de la famille qui ne reflète pas la réalité dans de nombreux pays d’origine : à quelques exceptions près, seuls les conjoint·es et les enfants mineurs non mariés sont concerné·es. De plus, les procédures sont longues et les documents requis, en particulier pour les réfugié·es, souvent indisponibles. Une personne dont un frère ou une sœur par exemple réside depuis longtemps dans un pays de l’UE n’a aucune chance d’entrer légalement sur le territoire. Une redéfinition élargie de la notion de famille, la simplification des procédures et la disposition de suffisamment de personnel pour vérifier au plus vite la situation socio-économique du demandeur·euse et s’assurer que les membres de la famille ne dépendront pas de l’aide sociale après son entrée dans l’UE réduirait le nombre d’entrées irrégulières. On retrouve ici une relation avec le modèle de parrainage : les frais n’incomberaient pas aux membres de la communauté, mais à la famille résidente.
Ce ne sont pas juste des « travailleur·euses immigré·es ». De la nécessité d’une nouvelle politique migratoire
Nous ne ferons ici qu’aborder rapidement le sujet complexe de l’immigration économique. Il est certain que la formule selon laquelle plus la politique migratoire est restrictive, plus le nombre de personnes susceptibles de demander l’asile afin d’obtenir un titre de séjour est élevé reste aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre dans toute l’Europe, les chances de trouver un emploi, y compris après une immigration irrégulière ou après avoir dépassé la durée du visa, sont très élevées. Avec la baisse continue de la natalité et le vieillissement de la population, cette tendance devrait se poursuivre, peu importe la conjoncture économique. Restreindre l’entrée légale aux seuls travailleur·euses hautement qualifié·es ne semble pas correspondre à la réalité des marchés du travail. Un modèle testé en Italie au début du siècle, pendant quelques années seulement, hélas, de délivrance de visas à des fins de recherche d’emploi à durée limitée devrait être réexaminé. Dans le secteur en expansion des services à la personne, le contact personnel entre l’employeur·euse et l’employé·e apparaît indispensable, ce qui implique la présence du/de la migrant·e. Là encore, un parrainage temporaire, par exemple par des organisations patronales ou des syndicats, pourrait réduire le risque supporté par les comptes sociaux.
-
Immigration légale, une solution gagnant-gagnant
Exception faite de la dispense de visa pour les ressortissant·es de certains pays, toutes les « passerelles » présentées ici offrent aux États l’avantage
■ de pouvoir contrôler les réfugié·es et les migrant·es avant leur entrée sur le territoire afin de détecter d’éventuels risques pour la sécurité et la santé ;
■ de permettre aux autorités compétentes du pays d’accueil, avant toute entrée sur le territoire, de connaître les données personnelles des voyageur·euses ;
■ de déterminer l’État membre compétent avant même l’entrée sur le territoire ;
■ de supprimer les procédures d’asile aux frontières extérieures et la privation de liberté qui en découle, conformément au nouveau règlement sur les procédures d’asile ;
■ de connaître avant l’entrée sur leur territoire le nombre d’immigrant·es demandant l’asile, un emploi ou le regroupement familial, et de pouvoir ainsi planifier leur arrivée ;
■ de pouvoir préparer l’accueil des réfugié·es dans le temps et en nombre.
L’amélioration de la gestion de l’asile et des flux migratoires [11]visée par le « nouveau pacte » ne peut s’opérer qu’en développant les voies d’entrée légales afin qu’elles constituent une alternative réaliste à l’immigration irrégulière.
Traduction par Pascal Pierron, édition par Mathilde Wahl | Voxeurop
Les opinions et points de vue énoncés dans cet article ne reflètent pas nécessairement ceux de la fondation Heinrich Böll Paris.
[1] European Parliament, Briefing, Walls and Fences at EU-Borders, EPRS Bri(2022)733692_EN.pdf
[2] Pour une liste et une analyse de ces accords, voir C. Hein, Maginot Line Around Europe? Assessing the Impact of EU- Agreements with MENA countries on Migration Flows to Europe, 2025,
https://mp.luiss.it/archives/maginot-line-around-europeassessing-the-im…
[3] E. Niemayer, Unequal access to foreign spaces: how States use visa restrictions to regulate mobility in a globalized world; London School of Economics, Research online, 2006
[4] D. Thym, Temporary Protection for Ukrainians: the Unexpected Renaissance of „Free Choice“, in: EU Immigration and Asylum Policy, 7 March 2022,
https://eumigrationlawblog.eu/temporary-protection-for-ukrainians-the-u…
[5] https://www.unhcr.org/global-trends. Chiffre datant de la fin 2024.
[6] Au premier semestre 2025 les Vénézuéliens constituent le groupe le plus important de demandeurs d’asile, depuis que le nombre de réfugiés syriens a fortement diminué. Toutes les données proviennent de : https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends
[7] Directive UE 2024/1350 du 14 mai 2024
[8] Fin 2025, une publication exhaustive rédigée par des chercheurs de différents pays et coordonnée par l'université de Viterbo paraîtra sous le titre « Towards a European Model of Community Sponsorship for Migrants and Refugees: The Legal Perspective » (Vers un modèle européen de parrainage communautaire pour les migrants et les réfugiés : la perspective juridique). Elle examinera les différentes expériences internationales en vue de leur transposabilité dans les États membres de l'UE.
[9] Pour une version abrégée, voir https://www.refworld.org/reference/research/unhcr/2003/en/87309
[11] Directive UE 2024/1351 du 14 mai 2024