Il y a 60 ans paraissait La grimace de Heinrich Böll. Ce roman reste l’un de ses plus grands succès, mais aussi l’un des plus controversés. Markus Schäfer décrit les circonstances de l’époque, l’intérêt du livre et son retentissement singulier qui perdure.
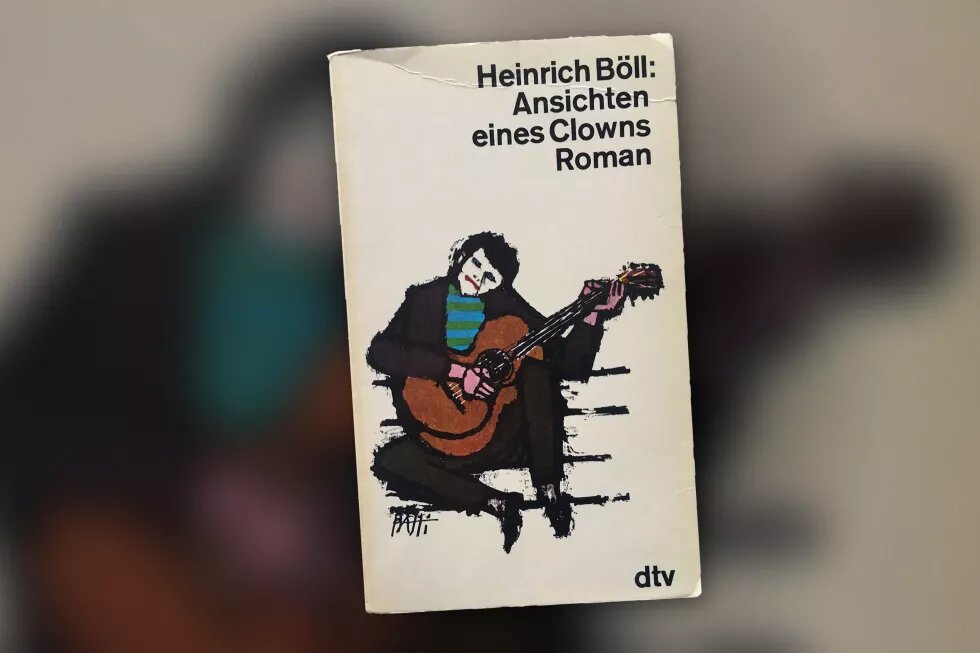
Dans les années 1950, Heinrich Böll a conquis un grand nombre de lecteurs et de lectrices. Ses procédés littéraires et sa critique sociale contemporaine lui permettaient alors de toucher un large public, malgré la prépondérance du catholicisme dans la région rhénane de Cologne et de Bonn. Aujourd’hui, la dimension religieuse de son œuvre peut en dissuader la lecture. Toutefois, si l’omniprésence de l’Église catholique semble à présent dépassée, l’essentiel demeure. La grimace reste accessible à tous et à toutes, même sans connaissance des traditions catholiques.
La grimace a paru en mai 1963. Sa prépublication dans le Süddeutsche Zeitung avait alors déjà suscité un débat animé. Les critiques, qui avaient souligné la complexité narrative et le caractère expérimental du précédent roman (Les deux sacrements), portaient cette fois-ci sur le contenu. La grimace se déroule un soir de 1962, sur une durée de trois heures environ. Un clown, narrateur de ce roman à la première personne, dévoile sa vie à travers des flashbacks et des visions, en exposant ses points de vue avec émotion. Ce moi narratif ne caractérise les personnages et les événements dont il se souvient qu’à travers sa perception subjective.
Le roman dépeint essentiellement la relation entre Hans Schnier, le clown, et Marie Derkum, la femme l’ayant quitté après sept ans d’union. Même si Böll affirmait qu’il ne s’agissait que « d’une histoire d’amour, rien de plus », il se doutait bien que la réception critique serait houleuse : au moment de la parution, il se trouvait sur l’île d’Achill en Irlande, loin du tumulte. Aucun livre n’avait alors occasionné tant de controverses dans la presse. Pendant des mois, les critiques les plus renommés ont commenté le roman dans le journal Die Zeit. Entre le 10 mai et le 21 juin 1963, une rubrique hebdomadaire lui a même été consacrée, exposant une grande diversité de réactions.
Malgré la variété des positions, le débat s’est focalisé sur le « règlement de comptes » de Böll avec l’Église catholique. Ainsi, le critique Werner Hofmann a intitulé ses chroniques « Le fou et les catholiques allemands » (Die Glocke, 24/09/1963), ou encore « Le catholicisme comme chiffon rouge » (Die Zeit, 31/05/1963). Les organes de presse catholiques et les journaux proches de l’Église alimentaient la polémique. À l’instar de nombreux commentateurs, ces médias ignoraient la volonté de l’auteur de relater les événements du point de vue exclusif d’un narrateur marginal. En effet, loin d’une représentation factuelle ou objective, le roman adopte une perspective singulière empreinte d’émotion. Même si certaines opinions du clown correspondent aux prises de position politiques et aux convictions morales exprimées par l’auteur, son point de vue n’est pas explicitement celui de Heinrich Böll.
Indépendamment de la critique littéraire, le livre a eu un effet libérateur chez les jeunes des milieux religieux encore astreints au catéchisme. Cet enseignement transmettait aux élèves catholiques les éléments fondamentaux de la doctrine de l’Église, notamment en matière de « nature humaine », interdisant la sexualité hors mariage, la masturbation et la contraception, et considérant l’homosexualité comme un « péché ». En 1985, dans une postface pour une nouvelle édition, Heinrich Böll reconnaissait que sa critique du milieu catholique pouvait paraître anachronique dans le contexte des années 1980.
Lors de la parution, le scandale portait sur le concubinage entre les personnages Hans Schnier et Marie Derkum. Certains estimaient que le clown provocateur s’apitoyait sur son sort et formulait des reproches injustifiés sur le contexte social et les conventions religieuses. À cette époque, la cohabitation entre hommes et femmes était régie par un modèle de référence. La politique s’orientait vers une image de la famille bourgeoise promue par le gouvernement Adenauer, sous l’influence de l’Église catholique. En tant que chef de famille, l’homme pourvoyait aux besoins du foyer tandis que la femme n’exerçait pas d’activité professionnelle, mais s’occupait du ménage et des enfants. La doctrine catholique du droit naturel et social, qui attribue à chacun une place précise dans l’ordre de la Création, servait de base à cette idéologie familiale conservatrice.
La cohabitation illégitime d’un couple ne cadrait pas avec cette vision du monde, mais elle ne suscitait déjà plus l’indignation dans le milieu des années 1960 (en particulier après le mouvement étudiant de cette période). En revanche, d’un point de vue législatif, le concubinage entre Marie Derkum et Hans Schnier était encore répréhensible en 1963, puisque la loi n’a été modifiée qu’en 1974. Pour l’Église catholique, la sexualité ne pouvait avoir lieu que dans le cadre du mariage à des fins de procréation. La vie commune des couples non mariés était qualifiée de « fornication » et de « péché ».
Dans le roman, le clown Hans Schnier se dresse contre l’ingérence des représentants de l’Église dans sa relation intime avec Marie. Il remet en question les principes d’ordre abstraits qu’il compare à une « chambre de torture ». Selon lui, l’influence permanente de l’Église aurait déstabilisé Marie et contribué à l’échec de leur relation. Pour l’institution religieuse, la provocation résidait dans le fait que le clown, à l’image de Böll, contestait à l’Église le droit de légiférer et d’administrer le mariage chrétien. En effet, contrairement à tous les autres sacrements, les futurs époux s’administrent eux-mêmes le sacrement du mariage.
Soixante ans après la publication du roman, les générations actuelles peinent à imaginer l’influence de l’Église catholique sur la politique et la société d’après-guerre. Après l’abandon de la foi dans le national-socialisme, la société allemande avait besoin de retrouver un sens religieux fort. L’ascendant de l’Église catholique et du clergé était considérable. La religiosité normée par l’Église, dont l’autorité morale était largement reconnue, orientait les valeurs de la société.
Avec le chancelier Adenauer, le président de la Conférence épiscopale allemande (cardinal Frings), et le président du Comité central des catholiques allemands (Karl Friedrich Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg), les catholiques influençaient les décisions politiques de la République fédérale. Pour la première fois dans l’histoire allemande, ils n’étaient pas en minorité par rapport aux protestants. Le Comité central des catholiques allemands, composé d’hommes politiques influents, jouait un rôle majeur à tous les niveaux de décision.
Or, c’est précisément ce lien étroit entre le gouvernement et l’Église que Böll a critiqué très tôt. Il a notamment décrié l’absence d’opposition de l’Église au réarmement et à l’instauration de l’armée fédérale dans les années 1950, ainsi que le soutien électoral direct fourni à la CDU/CSU. En 1958, son essai Lettre à un jeune catholique soutenait que l’union de la CDU avec l’Église dénaturait l’essence de cette dernière. Il réprouvait la destruction des valeurs chrétiennes au profit de prétentions au pouvoir, les influences institutionnelles, et l’instrumentalisation d’une certaine vision réduisant la morale à la morale sexuelle, mais occultant systématiquement la morale politique.
Böll exprimait sa critique envers l’Église catholique officielle et le catholicisme associatif dans des essais et des interviews. Il ne cessait de comparer les prétentions de la société ouest-allemande à se fonder sur le christianisme avec la réalité, en constatant que les valeurs chrétiennes telles que la compassion et la fraternité n’étaient pas érigées en normes sociales. Il a fait de cet écart entre revendications et réalité un thème récurrent de ses romans. On lui reprochait alors d’accorder plus d’importance aux visées moralisatrices qu’à la littérature. Ses propos, selon lesquels l’Église catholique refoulait des valeurs fondamentales telles que l’humanité et la fraternité, en raison de ses propres ambitions, étaient taxés d’arrogance. Le qualifier de moralisateur ne visait qu’à discréditer son travail littéraire, à le diffamer et à empêcher toute discussion de fond.
Bien qu’atténué, le préjugé selon lequel Böll serait un moralisateur, et non pas un auteur réfléchi traduisant dans son œuvre les thèmes et les problèmes sociaux de son époque, perdure. Ses publications ultérieures ont élargi la portée de La grimace en montrant que la situation concrète, apparemment sans issue, vécue par le clown, pouvait être transposée symboliquement à d’autres conditions, époques et circonstances.
Hans Schnier proteste contre les conventions religieuses et sociales qui entravent son projet de vie. La question de savoir qui définit ces normes et principes d’ordre ne se pose pas explicitement, mais elle est évidente. En 1982, dans une préface au livre de Walter Warnach Wege im Labyrinth, Böll a comparé l’ambition du roman à une « résistance contre les forces et les groupes complaisants qui s’appropriaient ce que l’on ne peut pas posséder, le christianisme et la démocratie, et en revendiquaient la propriété exclusive ». La narration à la première personne lui a permis d’incarner cette impulsion de résistance de façon totalement subjective. Ainsi, c’est le clown qui dénonce une administration catholique suffisamment puissante pour imposer « certains ordres », contrôler, réguler et moraliser les besoins humains, menacer de sanctions et faire preuve d’un autoritarisme impitoyable et implacable. Dans un entretien accordé en 1969 à la Norddeutsche Rundfunk, Böll a souligné la nécessité de discerner les différentes formes d’administration :
« l’administration totale est en réalité un processus fasciste qui existe également, selon moi, dans ce monde apparemment démocratique. C’est ce que j’essaie d’exprimer en tant qu’auteur, sans le qualifier de fascisme qui n’est qu’un mot, disons, controversé, désignant de nombreux phénomènes. Mais pour cela, j’ai besoin d’un roman entier, dans lequel le mot fascisme n’apparaît pas, pour révéler que ces éléments font partie de la société. »
Il s’agissait pour Böll de faire voler en éclats les structures autoritaires en se référant à l’Église catholique, parce que ce modèle lui était le plus familier. C’est ce qu’il a déclaré en mars 1969 dans une interview avec Klaus Colberg pour la Österreichischen Rundfunk : « je pense que [le roman] est également transposable à d’autres structures autoritaires. Pour moi, le problème n’est pas religieux, mais structurel ».
La modernité de la pensée de Böll apparaît dans la révolte du clown contre les normes qui lui sont imposées et qui l’empêchent d’accomplir son dessein. Une telle perspective peut nous inciter à découvrir ou à redécouvrir ce roman. Hans Schnier dénonce les modèles de pensée prédéfinis et défend sa liberté individuelle. Il refuse de se conformer aux attentes, même si cela implique un déclassement social. Les contradictions auxquelles il est confronté sont en grande partie obsolètes, mais le rouage de base, l’affirmation de sa propre autonomie face aux exigences de la société, n’a pas changé. C’est là que réside l’invitation à une vie résistante, dans une société démocratique qui a besoin de pluralité.
Traduction par Céline Michaud | Voxeurop

